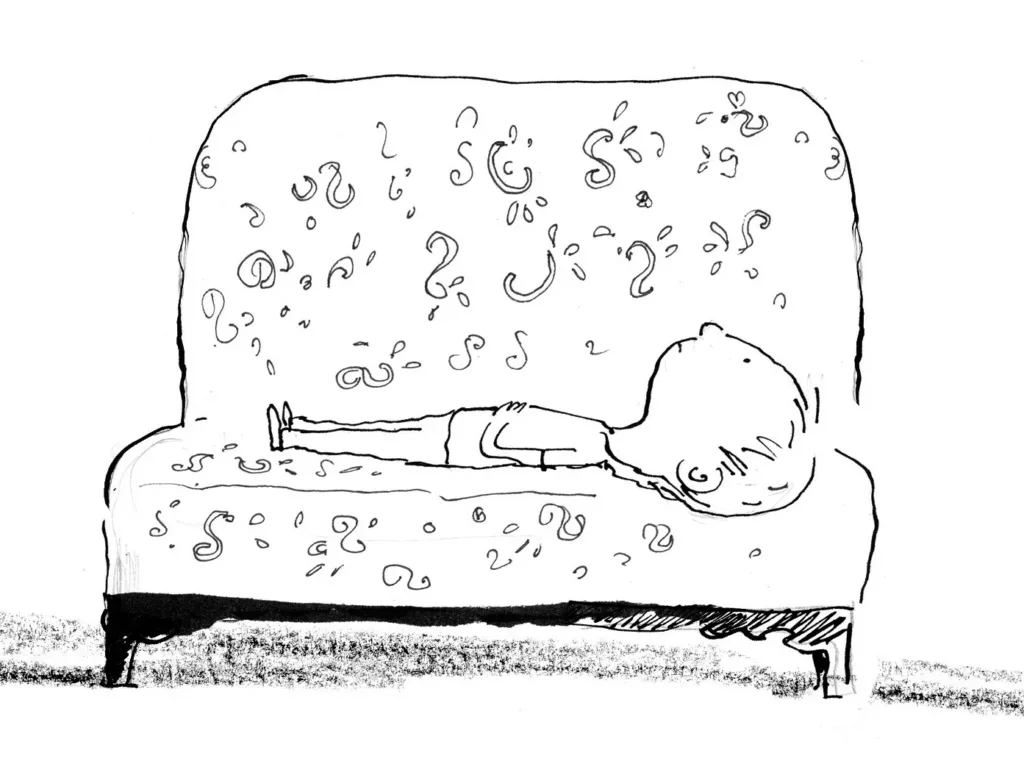Alors que l’Académie Nobel vient de récompenser l’écrivain norvégien, Jon Fossé, Abdulrazak Gurnah – primé en 2021 – publie un nouveau roman au souffle impressionnant. Cet auteur tanzanien, né à Zanzibar mais installé en Angleterre, creuse les plaies liées à la colonisation ou à l’exil. Ainsi, il nous emporte vers son continent africain d’origine, en proie à la colonisation européenne. Mais voilà qu’un loup souhaite soudain dévorer toutes les parts du gâteau : l’empire germanique et sa redoutable Schutzruppe askari, alias l’armée coloniale allemande. Même si elle semble surprise par « la constance dans le refus des peuples à devenir sujets de l’Afrique de l’Ouest allemand », là où elle passe, elle fait d’innombrables ravages. Ainsi, Ilyas est kidnappé pour agrandir ses troupes, mais il rêve de retrouver les siens, dont sa sœur Afiya. Elle-même subit l’oppression familiale pour rentrer dans les rangs d’une future femme respectable. « Elle sentait quelque chose s’étriquer en elle. C’était une kijana, une jeune fille qui apprenait l’amertume infinie de la vie recluse des femmes. » Or au fond d’elle, cette rebelle n’aspire qu’à l’amour et à la liberté. Un désir que partage Hamza. Lui aussi a dû apprendre à s’effacer dans l’ombre d’un commandant allemand cruel. Comment réveiller les étincelles de la résilience et la renaissance chez des âmes blessées ? Imposant, Abdulrazak Gurnah ne cesse de porter ses romans aux quatre coins de la planète. Voici son regard sur le monde d’hier et d’aujourd’hui.
Vous avez grandi sur l’île de Zanzibar, dans un environnement portuaire cosmopolite. « Un port étant le carrefour de nombreuses cultures et histoires », en quoi a-t-il influencé le futur écrivain que vous êtes devenu ?
Il s’agit de ma première compréhension du monde. En évoluant en bord de mer, j’avais l’impression que le monde venait à moi. C’est grâce à tous ces gens de passage et leurs multiples histoires, que j’ai senti que je faisais partie de lui. Dès l’âge de 5 ans, j’ai été éduqué avec le Coran. Ces cours ne consistaient pas seulement à apprendre à lire, mais à m’abreuver de nombreux récits, que ce soit celui du Prophète, des femmes ou de l’histoire de l’islam. Ces récits fondateurs ont déterminé mon regard sur le monde et m’ont appris à poser des questions. Parallèlement, j’ai été biberonné aux petites histoires orales et aux grands penseurs. Tous ces souvenirs vivaces demeurent, pour moi, une importante source d’inspiration.
A l’instar de l’un de vos personnages, Ilyas, « étiez-vous un enfant plein d’imagination » ?
Je crois que oui (rires). Mon cours préféré était d’ailleurs celui où l’on rédigeait des rédactions, dans nos bulles silencieuses. Mais même si j’aimais ça, il ne m’est pas venu à l’esprit d’embrasser une carrière d’écrivain. Il faut dire qu’il n’y avait pas vraiment de modèle auquel se référer. La plupart des livres publiés venaient d’ailleurs. Dans ma culture, on se devait plutôt d’exercer un métier utile, comme celui d’avocat ou de médecin. Ainsi, la littérature était réduite à un hobby. A quoi servait-elle donc ? Aujourd’hui, je répondrai que – tout comme les autres formes artistiques – elle fait de nous de meilleurs êtres humains. Lorsqu’elle est engagée, elle contribue à mieux comprendre le monde et soi-même. Son objectif ne semble guère utilitaire, mais elle remplit ma vie.
Vous percevez-vous comme un écrivain tanzanien, susceptible d’éveiller des vocations ?
J’ai beau être issu de Zanzibar, je ne me perçois pas spécifiquement comme un auteur de là-bas, mais comme un écrivain tout court. Bien que j’y mette des parts de moi, j’avoue ne pas aimer la littérature identitaire. Le fait que je n’écrive pas dans ma langue maternelle, mais en anglais, accentue cela. Contrairement à l’époque de mon enfance, il y a désormais des milliers d’auteurs africains, traduits aux quatre coins de la planète. C’est cela qui renforce l’aspiration de la jeune génération. Si mon Prix Nobel y contribue aussi, je m’en réjouis.
Votre héros Hamza apprend à lire et à écrire avec son bourreau allemand. Quel monde s’ouvre à lui ?
Il savait déjà un peu écrire, mais ne comprenait pas vraiment tout. Or lire et écrire constituent des outils formidables. Ils s’avèrent si puissants, qu’ils sont synonymes de pouvoir. Le soldat allemand ne tient guère à être didactique, il vise plutôt à le défier en lui enseignant la poésie à travers des textes monumentaux. Hamza apprend à absorber et à comprendre Shakespeare ou la philosophie. Ils lui montrent que la littérature n’appartient pas à un lieu ou une personne, mais à nous tous. Cela lui ouvre le champ des possibles.
Qu’est-ce qui rend les petites gens, qui peuplent vos romans, si héroïques ?
Les petites gens, je les connais par cœur, parce que j’en suis moi-même un. S’ils sont généreux et bons, à l’instar de certains personnages, peu importe qu’ils manquent de vertus ou de compétences particulières. Ils se montrent héroïques à mes yeux car ils affrontent les traumatismes. Certes, ils ne s’en sortent pas toujours, mais ils essayent d’avancer quand même. On perçoit toujours la résistance comme un combat armé, or il existe beaucoup de résistances silencieuses, comme celles que je décris dans ce roman. Bien que n’étant pas historien, je montre qu’il existe une autre dimension au conflit mondial de 1914. Il est méconnu car il touche des petites gens en Afrique. Pendant longtemps, ce sont les Européens qui ont créé et écrit l’histoire africaine. Je ne prétends pas qu’elle soit entièrement faussée, mais il me semble important de la compléter et de l’écrire à mon tour. Hannah Arendt a surtout analysé le totalitarisme par rapport au nazisme, or il est également présent dans le colonialisme. Cette expérience, qui consiste à voler des terres et des richesses, puis à déclarer la supériorité de la race allemande, s’est d’abord incarnée sur le sol africain, au début du siècle dernier. Cela ne faisait que préfigurer la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui voulait exterminer les juifs et à conquérir le monde.
Alors que les dirigeants allemands d’antan se vantaient d’une « Zivilisierungmission » (une mission de civilisation), en quoi la colonisation, la guerre et la quête de pouvoir se montrent elles cruelles, violentes et absurdes ?
J’y ajouterai : rustres, irrationnelles et chaotiques. Dire que ceux qui en souffrent connaissent à peine la signification du mot guerre. La plupart des victimes sont les petites gens, qui sont emportés par la faim, la maladie et la précarité. La guerre me paraît toujours incompréhensible, d’autant qu’elle est principalement menée par des pays dits « civilisés ». Voyez l’épisode historique que retrace ce roman, à savoir un conflit européen qui débute en Afrique et s’étendra avec les mêmes protagonistes allemands, sur le Vieux continent. Pourquoi continuons nous encore et encore à faire la guerre ? Ça n’a aucun sens, mais il faut croire qu’elle est typique des sociétés humaines. On n’a pas appris à écouter l’Histoire, alors la destruction est toujours en cours. Même si ça semble injuste, l’Histoire humaine est une suite guerrière, qui fait clairement partie de nous.
Il en va de même du colonialisme qui traverse votre œuvre. Quelle en sont les séquelles ?
Où qu’il passe, le colonialisme transforme tout. On prône son apport positif, comme l’éducation ou la technologie, or il laisse surtout des traces malheureuses et des divisions, au sein de mondes autrefois unis. Une grande partie des violences actuelles ont été engendrées par des invasions passées. Ceci explique, par exemple, l’instabilité au Niger où des extrémistes musulmans veulent faire exploser une Nation. Cependant, personne ne veut céder ses terres. Cette instabilité mondiale pose la question de la responsabilité… Je reste toutefois optimiste car je sais qu’on doit affronter ces problèmes.
Tous ces troubles provoquent l’exil, la perte de citoyenneté et d’identité. Pourquoi explorez-vous l’aliénation à travers Hamza, qui « devient l’ombre de lui-même » ?
La guerre ne représente pas seulement un grand événement historique, elle affecte durablement les gens. Alors il me semblait important de montrer des personnages comme Hamza et Afiya, qui retrouvent leur chemin malgré les traumas. Opprimé par un officier allemand très cruel, Hamza ne perd jamais sa place intérieure, en dépit de son isolement dans cette société guerrière. Il est perdu, mais il n’a pas perdu la notion de qui il est, au fond de lui. On sous-estime souvent la ressource des âmes.
En quoi est-ce si violent d’être arraché à son pays et d’être considéré comme un « étranger » ailleurs ?
J’ai moi-même quitté ma terre de Zanzibar car je voulais découvrir d’autres horizons. Et oui, 18 ans n’est peut-être pas l’âge le plus intelligent (rires), mais je rêvais d’apprendre le monde. J’aspirais à une autre existence que celle qui m’était offerte. Pourquoi se priver d’un désir de vie meilleure ? Même si c’était dangereux et que j’ai perdu des choses intimes, cette trajectoire possède aussi un sens de l’aventure. Devenir un étranger, seul et désargenté, me paraissait effrayant, voire douloureux, mais j’avais aussi le sentiment de vivre quelque chose d’excitant dans un nouveau lieu, l’Angleterre.
La migration est au cœur de vos écrits, pourquoi ?
Elle n’est pas nouvelle, tant elle existe depuis la nuit des temps, que ce soit par grappes individuelles ou par vagues collectives. Ce qui est inédit, c’est que la migration s’opère désormais du Sud au Nord, qui est devenu bien plus riche. Le Vieux Continent panique en disant que les migrants vont détruire leur prospérité, or un jour, c’est l’Europe qui se fera plumer par d’autres pays plus puissants et fortunés. Tout cela m’enrage, parce que c’est à cause de la colonisation européenne et des dégats engendrés par les pillages de nos terres, que les gens doivent fuir. Voyez ce qui se passe en Afghanistan, en Syrie ou en Lybie. Les Européens ont un sens de la supériorité qui me dégoûte car ils rejettent les migrants, au nom de leur soi-disant infériorité. Or ces gens font partie de nos sociétés.
Les femmes sont souvent les grandes négligées de l’Histoire, pourquoi leur donnez-vous une voix à travers Afiya qui « découvre l’amertume de la vie recluse des femmes » ?
Il est vrai que les femmes ne sont point représentées, y compris dans l’Histoire récente. Ça reste lié à l’éducation. Les femmes de la génération de ma mère n’ont pas été à l’école. Cette privation se poursuit hélas avec celle de mes sœurs, alors que mes frères et moi avions le droit d’y aller. Ces inégalités se retrouvent aussi parmi les migrants, puisque ce sont plutôt les jeunes hommes qui partent pour l’Europe, en laissant les femmes à l’abandon. Voilà pourquoi, j’estime qu’il faut être conscient de leur situation.
Vous nous offrez aussi un magnifique roman d’amour, en quoi a-t-il le pouvoir de nous ramener à la vie ?
Que serait un roman sans histoire d’amour (rires) ? Je suis persuadé qu’on peut sortir d’un événement traumatique grâce à la générosité d’autrui. La plus intime d’entre elle est la relation amoureuse, qui nous sort du chagrin et de la perte. Son pouvoir est salvateur, parce qu’il permet de trouver la meilleure part de soi. Mais il s’agit aussi d’une forme de sacrifice pour comprendre l’Autre et s’en accommoder, sans pour autant se laisser écraser. Grâce à l’amour, on se redécouvre. J’ai une grande foi dans ce don de soi, qui suscite une incroyable résilience. La générosité permet d’aider les gens qui sont dans la violence ou le besoin. Je pense que les êtres humbles ont même la possibilité d’être généreux envers ceux qui les ont fait souffrir.
Ce livre s’intitule Afterlife, croyez vous à la vie après la mort ?
Ici, il s’agit plutôt d’un retrait de soi dans l’abîme et la mort, mais une seconde vie s’avère néanmoins possible.
Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.
Photo : Mark Pringle
L’auteur : Prix Nobel de littérature de l’année 2021 , Abulzarak Gurnah est un écrivain tanzanien et un universitaire spécialisé dans les études postcoloniales. Connu pour son roman Paradise, l’auteur s’inspire de son histoire personnelle pour réfléchir aux thématiques liées à l’exil.
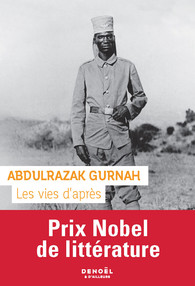
Abdulrazak Gurnah, Les vies d’après , 4 Octobre 2023 (Éditions Denoël)
Traduit de l’hébreu par Sylvette Gleize
À retrouver chez mon libraire.