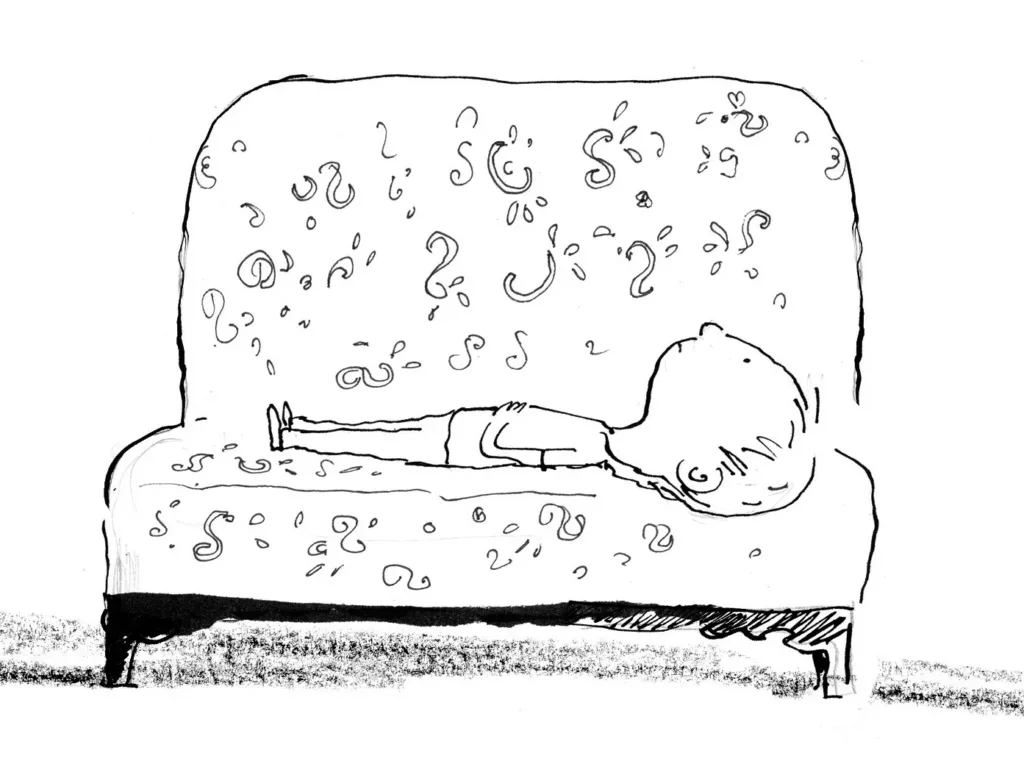Vous avez toujours été « avide de lecture ». Qui vous en a donné le goût ?
Ma mère, qui achetait toujours des best-sellers. Ça allait de Norman Mailer à Stephen King. La maison était remplie de livres. Puis est venu le cours d’anglais, à l’école. Je n’en ratais pas un, tant j’aimais y découvrir des nouvelles – comme « L’homme invisible » – ou des romans. La pop culture musicale ou cinématographique m’a aussi toujours nourri. Il m’est impossible de faire autre chose que d’écrire…
Ce nouveau roman est dédié à Beckett, pourquoi ?
Parce que c’est mon fils (rires) ! Mais c’est également ce dramaturge essentiel, chez qui j’apprécie ce mélange de dépression et d’observations incroyables. Il fait partie de mon panthéon théâtral, au même titre que Pirandello. J’ai toujours adoré lire des pièces. Pour mon anniversaire, je viens de recevoir celles d’August Wilson, un dramaturge américain qui a également reçu le double Prix Pulitzer.

La Harvard Review vous décrit comme « un caméléon de la littérature ». Qu’est-ce qui vous donne envie de changer constamment d’ambiance ?
Je ne fais pas exprès, mais il est vrai que j’aime toutes sortes de styles : le fantastique, le réalisme ou les grands romans comme « Moby Dick ». Il faut dire que je suis vraiment « un junky de la pop culture ». Ce sont des artistes comme David Bowie qui m’ont appris ce côté multidisciplinaire. Il changeait d’ambiance à chaque album.
Lorsque vous écrivez, éprouvez-vous la sensation de « plonger dans le sous-marin » de votre imagination ?
Je ne me reconnais pas dans cette métaphore, mais quand je marche dans la rue, des images surgissent d’un coup. Comme si j’écrivais constamment dans ma tête. C’est à la fois une bénédiction et une malédiction. Tantôt je suis très inspiré, tantôt je dois me forcer à m’asseoir pour résoudre un problème créatif. Cela exige beaucoup de travail. Si ça ne fonctionne pas, j’avoue que cela me mine, mais on doit avancer sans se laisser distraire ou décourager.
Votre héros Carney « apprend très tôt à ne pas poser de questions ». Quelles questions souhaitez-vous soulever dans ce nouveau roman ?
Je le décris comme un roman noir. A travers le portrait de cet homme, je montre en quoi la classe sociale, la race ou la ville agit sur quelqu’un. Je fais évoluer ce personnage dans le temps, afin de saisir comment il affronte le monde. Survit-il à son environnement ou pas ? La classe sociale, la race ou la ville ne sont que des facteurs parmi d’autres. On se définit soi-même… Dans le cas de Carney, on ignore si l’aspect criminel vient de lui ou de son père. Il y a toujours une voix en lui qui le pousse vers sa noirceur. Est-ce inné ou acquis ? Qu’est-ce qui nous détermine ? Peut-on dépasser sa destinée ou est-on toujours ramené en arrière, dans son piège intérieur ? J’aime ce personnage qui embrasse tout, que ce soit le côté criminel ou le côté résolument optimiste.
Vous avez grandi à Harlem, jusqu’à l’âge de 5 ans. Quelle image en gardez-vous ?
Celle du Harlem des années ’70. Ce quartier de New York était dans un état terrible. Il y régnait la saleté, le danger d’une criminalité élevée et la corruption. En écrivant ce livre, je n’avais pas réalisé que je décrivais le Harlem de mes parents. C’est en questionnant ma mère, que j’ai ressuscité leur Harlem perdu. Ils ont connu ou vécu dans certains lieux décrits ici, à l’époque où la ségrégation y était toujours d’actualité. En lisant certains auteurs, dans ma jeunesse, j’ai compris que les villes pouvaient représenter des personnages majeurs. Découvrir tant d’histoires sur New York m’a beaucoup enrichi. C’était gratifiant de les intégrer à mon roman. Pendant la pandémie, je me suis amusé à chercher des endroits ou des bâtiments concrets, dans lesquels se déroulaient la vie de mes protagonistes. Une belle façon de me reconnecter à ma ville, dont j’étais coupé.
Comment avez-vous ravivé son atmosphère, si particulière aux sixties ?
Grâce à internet. On y trouve des pépites, comme des pubs pour meubles ou des films amateurs révélant des détails, tels que les chapeaux ou la langue d’antan. Ces archives, visuelles ou sonores, ce sont ajoutées aux biographies ou aux journaux dévoilant une autre manière de voir le monde ou la politique. J’aime collectionner toutes sortes d’histoires sur New York, comme celle du quartier qui a été rasé pour fonder Central Park. Que de trésors ! Ce qu’on cache, détruit ou reconstruit me fascine et revient souvent dans mon œuvre. Mon imagination se nourrit de tout. Ainsi, Harlem est le reflet des premiers migrants. Ils étaient composés d’Italiens, d’Irlandais ou de juifs issus d’Europe de l’Est. Sont venus ensuite les Portoricains ou les Noirs. Tous sont arrivés dans l’espoir d’un nouveau monde. Lorsqu’ils ont réussi à atteindre la classe moyenne, ils ont déménagé. Aujourd’hui, leurs petits-enfants reviennent à Harlem car c’est joli et pas cher. Ce dynamisme me captive.

Habituellement, Harlem est associé à la violence ou la drogue. Pourquoi est-ce important de montrer que ce quartier est aussi plein de vie ?
Ce n’est pas mon job de lutter contre les clichés, mais c’est vrai que dans ce roman, je voulais à la fois montrer la criminalité et les gens normaux. Chacun est juste humain, même les pires. Si on voit le monde à travers un flic corrompu ou les yeux du mafieux Vito Corleone (« Le Parrain »), on excuse presque leurs crimes. Certaines choses nous rendent beaux, alors que d’autres nous rendent monstrueux. C’est là que se situe toute notre complexité. Je souhaitais également décrire un Harlem disparu. Envahi par les grandes enseignes commerciales mondiales, il tient à préserver d’anciens bâtiments, où vivaient les migrants du XXè siècle.
L’Histoire se situe au cœur de vos derniers romans, est-ce une source d’inspiration inépuisable ?
J’ai aussi fait pas mal de livres sur l’époque contemporaine, mais j’avais le sentiment d’avoir tout dit sur le monde d’aujourd’hui. Pour saisir celui-ci, cela me semble plus fructueux de retourner au passé. Or on a beau le scruter, on a visiblement rien appris de nos erreurs. Le passé et le présent sont tellement liés… Si l’on se reconnaît dans « L’Iliade » d’Homère, sans pour autant être des soldats grecs, c’est parce qu’il capte l’essence de l’humanité : la cruauté, l’envie ou l’amour. Ainsi la vie de mon héros, Carney, est affectée par les effets de la Grande Dépression. Harlem incarne d’ailleurs ce mélange de grandes migrations. C’est notamment devenu un quartier black, parce que les Noirs issus du Sud du pays s’y sont réfugiés pour fuir la discrimination. Tant de gens rêvent de tout recommencer pour échapper à la réalité de classe ou de race, en Amérique.
Vous écrivez justement que « l’Amérique est un grand pays, où règne l’intolérance et la violence raciale ».
Les gens restent terribles dès qu’il s’agit de genre, de race ou de religion. Cela ne date pas de 1961 ou de 2021, comme le relatent mes romans « Underground Railroad » ou « Nickel Boys ». Ici, j’ai écrit la scène des violences policières avant le soulèvement lié à la mort de George Floyd (ndlr. étouffé par un policier blanc). Quand j’étais étudiant, j’étais déjà conscient des brutalités policières à l’égard des Noirs. Bien que n’étant pas pessimiste, je suis persuadé qu’il n’y aura pas de réformes à ce sujet. J’ignore si c’est inné ou acquis, mais je suis sûr que nous sommes mauvais et ce, peu importe qu’on ait un président noir ou que Trump perde les élections. L’Amérique demeure un pays très raciste, c’est pourquoi je continue à explorer l’histoire des Noirs. Voyez le personnage de Pepper qui reflète les inégalités des soldats, pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

En quoi cela nous renvoie-t-il au « savoir-faire américain dans toute sa splendeur : on crée des merveilles, on crée de l’injustice, on n’arrête jamais » ?
Ce « savoir-faire » n’est pas propre à l’Amérique. Tous les pays ont des idées nobles d’eux-mêmes, alors qu’ils font parallèlement des choses atroces. Mon roman se situe notamment en 1964, lorsque le pouvoir américain s’empare de la technologie spatiale. Au même moment, Harlem connaît une pauvreté extrême. L’Amérique est une terre paradoxale. A l’instar de Corney qui se croit noble, tout en glissant vers son aspect le plus sombre. Il a d’ailleurs peur de perdre sa famille ou son optimisme. Cet homme aspire à aimer et à être aimé, mais il a dû s’élever tout seul après la mort de ses parents. Les criminels sont optimistes, même s’ils sont parfois ramenés à la réalité. Face à eux, les flics jouent les antagonistes ou les vilains corrompus. On renferme tous, en nous, une part d’ombre et de lumière. Mes personnages veulent se transcender, parce qu’ils espèrent échapper au destin ou à la malchance. Moi-même, je souhaite parfois m’extraire de ma vie en plongeant dans un bon livre ou un film. Comment dépasser la dureté existentielle ? Je m’inspire surtout de l’Histoire et de la pop culture. Rien de tel que des zombies pour aborder l’apocalypse (rires). Autres passions : peindre ou composer des poèmes. Passer mes journées à écrire, à la maison, est aussi ma façon de refuser d’être quelqu’un de « normal ».
S’il est « important d’avoir un coffre assez grand pour tous nos secrets », en quoi nous constituent-ils ?
On passe la majorité de notre temps dans nos têtes, face à celui ou celle qu’on est. Cela m’amuse d’écrire sur des criminels car ils tentent de scinder leurs activités de leur vie sociale. Mais arrive un moment où l’on est face au vrai soi, qu’on se doit de contempler. Même si, contrairement à mes héros, on ne braque pas de banques, on possède tous nos secrets. Carney se présente à priori comme un homme d’affaire respectueux, bon père de famille. Une autre voix en lui l’invite cependant à faire des choses en dehors des normes et des lois sociales. Tout comme ses congénères, il espère prendre son destin en main. Ils sont obsédés par l’argent, or que faire si on a été un looser toute son existence ? Peut-on vraiment tout renverser ? Mes héros perçoivent la vie comme un coup de poker. Il suffit de tirer une carte pour basculer dans la fortune ou la chance, or le moindre pion peut susciter l’inverse. Si on ne croit pas en une vie meilleure, comment avancer ?
Grâce à l’amitié, qui est aussi au cœur du roman ?
Complètement. Carney et Freddy possèdent un esprit commun, mais vont-ils grandir ensemble ou se séparer ? Ici, c’est le premier tome d’une trilogie. Dans le second, c’est l’ancien soldat Pepper qui devient l’allié de mon protagoniste. Tous aspirent à un meilleur appartement ou une respectabilité au sein de leur communauté. Ce roman raconte surtout une envie d’appartenance. Qu’on le veuille ou non, personne ne peut s’abstraire du pouvoir du monde. Ses forces nous affectent, que ce soit à travers l’intrusion d’une belle-mère ou de l’histoire sociale dans la sphère intime. Parfois c’est une intrusion positive, comme Moskowitz le tuteur de Carney, qui apprécie l’expertise d’hommes plus âgés. Mes mentors à moi étaient plutôt les livres de Stephen King ou Toni Morisson.
La vie est-elle un jeu et si oui, quel risque êtes-vous prêt à prendre ?
Je perçois plutôt l’écriture comme tel. A chaque début de livre, je suis découragé par ce marathon, que je vais devoir courir pendant au moins un an. Comment écrire et finir un roman, sachant qu’une fois que c’est fait, on va s’attaquer au prochain ? On peut donc jouer et tout perdre… Le sens du danger est quotidien, mais que deviendrait-on sans espoir ? J’en suis à mon onzième livre, c’est toujours aussi effrayant et excitant (rires).
Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.
Des portraits réalisés par Jean-Luc Bertini
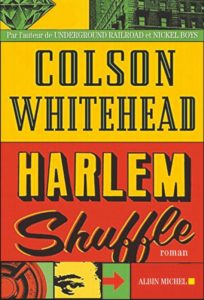
Colson Whitehead, Harlem Shuffle, janvier 2023 (Édition Albin Michel)
traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Recoursé
À retrouver chez mon libraire.