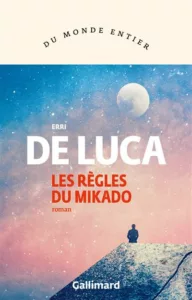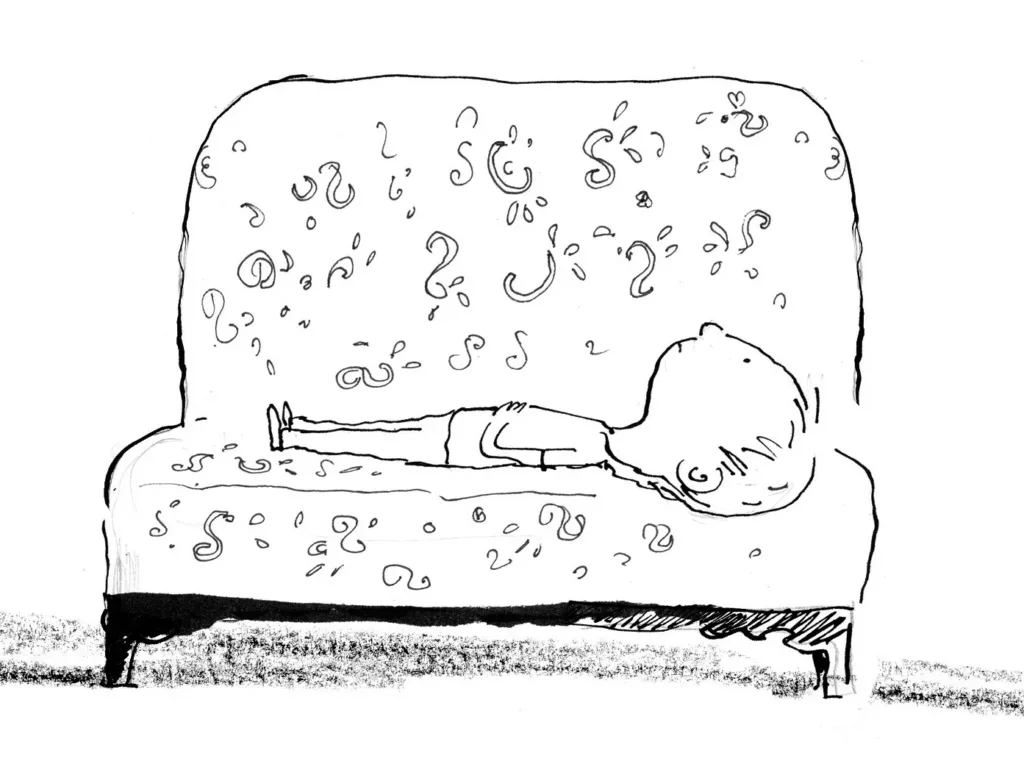Erri de Luca possède cette voix, à la fois pleine de douceur et de gravité, qu’on retrouve dans ses livres. Une voix de conteur, héritée de son enfance napolitaine, où il avait tendance à lire ou à écouter l’histoire des autres. D’autant que la Seconde Guerre mondiale a laissé des stigmates, y compris au sein de sa famille. Assoiffé de liberté, il fonce très tôt dans la vie active engagée. Cet ouvrier anarchiste s’inscrit dans les mouvements révolutionnaires d’extrême gauche, les manifestations sociales ouvrières ou les actions humanitaires. Ses mains calleuses témoignent de ce dur labeur, se frottant concrètement à la réalité. Mais un jour, elles s’emparent de l’Ancien Testament. Une nouvelle voie s’éveille en lui et lui donne la force de prendre la plume, à presque 50 ans. Depuis lors, chacun de ses romans (cf. « Montedidio » Prix Femina) est comme un caillou précieux, semé par le Petit Poucet dans une forêt dense. « Les règles du mikado » (éd. Gallimard) nous offre un huis-clos à ciel ouvert, une aventure pleine de doubles mystères. Alors qu’un vieillard se terre dans une tente – nichée au sommet d’une montagne italo-suisse – une jeune fille surgit au milieu de la nuit. Elle a fui sa famille et la promesse d’une vie oppressante. Bravant le danger, elle lui demande de la cacher. Se noue entre eux une amitié, tissée de dialogues, de silences et de correspondances. Un apprentissage de l’existence ou de la complexité de l’identité, qui passe par la lecture et l’écriture. Deux maîtres mots pour cet écrivain d’une grande sensibilité, intégrité et fidélité.
L’un de vos personnages affirme que « mon enfance a été un excercice de vie pratique, de mise à l’épreuve. » Qu’en est-il de la vôtre ?
J’ai eu une « enfance napolitaine » (rires), aussi fallait-il s’adapter au vacarme et à la misère de la ville. N’ayant pas ce tempérament, j’ai eu la chance de pouvoir m’enfermer dans ma chambre, inondée de livres. La lecture m’a appris à me couper de tout. Coincé dans des histoires pour adultes, j’y ai découvert le monde mystérieux de ces géants affrontant les grands défis de la guerre, des bombardements ou des tremblements de terre. Un véritable chaudron ! Le prophète Ezechiel disait d’ailleurs que « Jérusalem est une marmite et nous sommes la viande. »
Est-ce votre père qui vous a donné le goût des histoires ?
Mon père ne m’en racontait pas car il était peu présent. Les livres les relataient à sa place. Il lisait beaucoup, alors admirant cette activité, je me suis mis à la partager doucement, sans bénéficier de ses conseils. Je pouvais éplucher tous les titres par hasard. C’est un bon enseignement de la littérature, puisque ça correspond à la possible rencontre entre histoires et lecteurs.
Vous écrivez qu’il « faut une langue dans laquelle se réfugier ». Pourquoi la vôtre est-elle liée à votre mère ?
Parce que le napolitain est ma « langue-mère », la langue de mon intimité, celle avec laquelle je me parle à moi-même, celle avec laquelle je m’insulte. Celle avec laquelle je parle à mes proches ou mes disparus, celle dans laquelle je rêve. Telle est sa force. L’italien m’agite et me calme. Il correspond plutôt à la langue virile et silencieuse, parlée par mon père.
C’est aussi celle de vos livres, vous percevez-vous dès lors comme un écrivain italien ?
Je suis plutôt « un écrivain EN italien » qui a, effectivement, choisi d’écrire dans cette langue au cours de la seconde mi-temps de sa vie. Alors que mes réactions et mes émotions s’expriment en napolitain, l’italien met de l’ordre dans le flux de mon existence. Ainsi, l’italien est devenu ma « langue de résidence », c’est pouquoi on ne peut pas m’envoyer en exil. Ma liberté m’a été montrée par l’italien : même en prison, on ne pourra pas m’empêcher de la vivre.
En quoi êtes-vous un écrivain engagé, tourné vers le monde ?
Je ne suis pas un écrivain engagé car mes écrits n’expriment nullement des histoires engagées ou des opinions personnelles. Disons qu’à travers mes livres, je préfère tenir compagnie aux lecteurs. Dans ma vie, je me considère comme un citoyen qui prend des engagements. Impossible de me soustraire à la guerre, l’immigration, les batailles sociales ou politiques de certaines régions d’Italie ou du monde. Cet intérêt pour les affaires sociales répond à l’éducation que m’a donnée ma mère. Elle m’a appris très tôt la souffrance d’autrui, si présente dans la misère de Naples. Jamais elle ne m’a culpabilisé, mais j’ai compris que j’étais priviliégié, puisque j’avais accès à un toît, de la nourriture, la scolarité et l’amour. D’autres gamins en étaient privés. Cette instruction élémentaire m’a fait comprendre qu’on ne peut pas être indifférent aux manques d’autrui, tout en développant un vaccin permettant de supporter leurs souffrances. Ces dernières restent coincées en moi comme un point d’interrogation. Il m’est essentiel de trouver des réponses. Après les avoir cherchées collectivement, j’avais besoin d’en inventer personnellement. Pour la guerre en Ukraine, j’ai loué un van avec un copain, afin d’apporter de l’aide alimentaire à travers le pays. Ce ne sont que quelques gouttes dans le désert, mais toute goutte parvient à désaltérer quelqu’un.
Ce roman se situe dans la montagne et en bord de mer. Pourquoi est-ce absurde d’y tracer des frontières ?
Ces frontières ou ces subdivisions administratives sont absurdes, parce que la géographie ne les admet pas. Surtout en mer ou à la montagne, où il n’existe pas d’obstacles. La mer représente une voie liquide, la meilleure manière de communiquer. Il en va de même pour la montagne qui permet d’intenses échanges entre les gens qui s’y croisent. Nous, les Italiens, sommes de grands connaisseurs de la montagne, puisqu’elle nous protège, or c’est aussi à travers les Alpes que nous avons été envahis. On peut prendre possession d’un pays par le biais de ce système de passage, mais pas le percer.
Les clandestins ou les migrants font partie de ceux que vous défendez ardemment. Pourquoi leur donnez-vous un autre visage dans cette histoire-ci ?
Il n’y a pas de « clandestins » dans ce monde, juste des « voyageurs ». D’ailleurs, ce premier mot n’existe pas dans la Thorah. On y parle de « gher » – l’étranger – ou de « almanah » la veuve et « yatom » l’orphelin, à protéger. Nous sommes issus d’une civilisation méditerranéenne qui ne connaît pas le concept de clandestinité, mais elle l’a inventé. Les peuples se sont toujours déplacés dans l’Histoire, quelle qu’en soit la raison. Telle est la force de l’humanité. L’Italie incarne un pays de migrants. Impossible de vivre sans tous ces pauves, envoyés comme des messagers dans le monde. Combien de familles ne se séparent pas de l’un de leurs membres, afin que ce dernier aille se poser dans un autre coin de la Terre pour les aider ? Elles jettent ainsi des semances en l’air pour qu’elles puissent pousser ailleurs. J’y vois une forme de survie et de résistance.
C’est aussi ce qui anime vos héros ici. Pourquoi l’instinct protecteur du vieil homme s’éveille face à cette jeune fille ?
Tel est le mystère des rencontres, le bonheur des histoires. Mon héroïne ne tient pas à être adoptée, elle s’est arrachée de tout. Rebelle de nature, elle refuse de subir un mariage forcé avec un vieillard. Aussi s’échappe-t-elle de sa famille et son village, tout en sachant que cet arrachement sera irréparable. Elle devra même se défendre des persécutions des siens, qu’elle a déshonorés. C’est comme ça, que mon héroïne part à l’aventure, jour après jour. Tant de jeunes filles font ce geste en se perdant, parce qu’elles ne trouvent pas de tente pour les accueillir. Cette condition d’extrêmité humaine est souvent tolérée. En Italie, on a récemment connu le meurtre d’une jeune pakistanaise musulmane. Elle, qui était tombée amoureuse, a refusé le mariage forcé qu’on a voulu lui imposer. Alors elle a été tuée par un homme de sa famille, outré par cette envie d’adopter des coutumes occidentales. Cette coutûme des mariages forcés m’évoque une oppression individuelle, or certaines filles, comme mon héroïne, s’inventent une réponse rebelle. Quitte à connaître une liberté extrême.
Quel est le prix de votre liberté ?
Je ne l’ai pas encore déterminé… On ne peut pas la marchander, parce que c’est une somme inconnue qu’on n’arrive pas toujours à payer. Aussi reste-t-on endetté, y compris vis-à-vis de soi-même. Beaucoup d’entre nous y renoncent dans des moments spécifiques de leur vie. Dès l’adolescence, la liberté arrive à l’ordre du jour. La mienne a été de tout quitter, de renoncer à ma famille et ma ville natale, pour me jeter à la mer. Dans ce « désert », j’ai eu la chance de trouver beaucoup de gens mutilés comme moi. Cela m’a permis de construire « une caravane de liberté ». L’écriture ne pas offert la liberté de m’exprimer, elle consiste surtout à raconter une histoire, telle une longue lettre qu’on adresse aux lecteurs, afin que quelqu’un la lise.
Pour reprendre la métaphore de ce roman, l’écriture est-elle une forme de Mikado ?
Non, c’est plutôt une manière de me tenir compagnie. Le souvenir n’étant pas une archive, mais un trou noir, l’écriture laisse sortir de petits bouts de mémoire d’un glacier. Ici, il m’est venu à l’esprit une alliance entre une jeune et une ancienne personne, entre la vieillesse tournée vers le passé et la jeunesse restante, regardant l’avenir. Pour la première fois, on a une génération qui se doit d’imaginer le futur, en étant responsable quant à la survie de la planète. Or à l’âge qui est le mien, je suis coincé dans le présent. Pourtant, j’imagine un horloger incarnant le Temps. Le passé englobe désormais une grande partie de ma vie (rires), voilà pourquoi je peux en extraire des histoires. Les vieux comme moi sont dans le détachement, tout en imaginant l’avenir, comme une raie de lumière au sein d’une fôret dense.
« La vie des espions est romanesque, parce qu’elle doit inventer des identités et des biographies. » En cela, l’écrivain est-il un espion ?
Alors que l’espion doit se déguiser, l’écrivain doit rendre l’autre explicite. On a tous des secrets en nous, des mystères formant un double-fond. Cela donne lieu à une forme de coexistence, entre eux et chaque personne humaine. J’y vois une force et une consistance qui nous tiennent debout. Ce double-fond se retrouve à Naples, une ville surpeuplée à la surface, constrastant avec un sous-sol, digne d’une immense caverne. Il s’agit d’une cité pleine de secrets, bâtie sur du vide. Il y en a aussi dans la rencontre entre mes deux héros. Quel est le lien entre cet horloger et cette jeune fille, capable de lire les êtres dans le creu des mains ou des yeux ? Il ne s’agit ni d’amour, ni d’amitié, ni d’idéologie, mais leurs âges opposés les rend responsables l’un de l’autre.
Vous m’avez dit un jour, « Je ne fais pas partie de ceux qui inventent des histoires ou des personnages, j’exploite plutôt des vies que j’ai connues. » Ce roman-ci s’inspire d’un fait divers. Que reflète-t-il de « notre époque récente » qu’était le XXè siècle ?
Borgès soutient que l’Histoire a besoin de garder pour elle des secrets, qu’elle ne partage pas avec les historiens. Mon livre a été érigé sous la forme du dialogue, qui est par définition mystérieux. Y compris par écrit, via les cartes postales ou les correspondances, format littéraire par excellence qui n’existe plus. Je ne regrette pas ces échanges, mais aujourd’hui, nous avons basculé dans l’ère du monologue. Le dramaturge grec Echyle a imaginé, 500 ans avant J-C, l’entrée du dialogue dans le théâtre. Il permet à l’écrivain de se retirer pour que ses personnages racontent l’histoire de leur propre bouche. Dans cet exercice de clandestinité, l’écrivain est celui qui écoute les deux, pour que l’histoire jaillisse. Ainsi, je suis « un écouteur d’histoires ».
« J’étais sauvage, agressive, en fuite. A 15 ans, j’étais analphabète », avoue votre héroïne. Quel monde s’ouvre pour cette autodidacte, lorsqu’elle apprend à lire et à écrire ?
Elle va justement découvrir le monde et apprendre à le nommer. A mettre des mots sur son vécu ou son passé. Quand ma génération de révoltés est entrée en prison, il n’y avait pas de livres. C’est nous qui les avons apportés, afin de les faire circuler auprès des détenus. Grâce à cela, ils ont pu reconnaître leur histoire et lui donner, enfin, une forme orale. Cet acte de reconnaissance de soi donne à sa vie une haute définition d’elle-même. Je suis persuadé qu’à force de raconter des histoires, on offre un vocabulaire permanent permettant de déchiffrer sa propre vie. Quelle surprise de voir, dès lors, les prisonniers se mettre à écrire des lettres ou de la poésie. Ce passage de la conscience à soi n’est pas une question politique ou intellectuelle, mais humaniste.
Ce roman se veut-il un hommage à la solidarité ?
Je pense que la solidarité est une technique intellectuelle de la communauté humaine. Elle s’est organisée car elle nous permet de mieux se défendre dans l’aide mutuelle. Cette économie naturelle entre les hommes est comme une fraternité, un état d’âme.
Percevez-vous l’existence comme « un éternel jeu de Mikado, où les bâtonnets servent à interroger le destin » ?
Je ne reconnais pas le destin, c’est un imposteur. Du coup, je crois plutôt au chaos des événements, qu’à un jeu de billard, calculant la trajectoire des vies. Et oui, je suis « un estimateur du chaos » (rires), alors ne demandons pas trop à la vie. Dans le Mikado, les petits bâtonnets doivent se soustraire de façon inaperçue du chaos de l’existence. Aimant Epicure, j’espère que le jeune homme – que j’étais à 20 ans – pourrait se reconnaître dans le vieil homme que je suis devenu, s’ils étaient amenés à se rencontrer.
Si « il y a de la magie dans tout », où la voyez-vous dans la vie ?
Dans de petits instants de bonheur, dans la stupeur et la possibilité de se surprendre. Dans un sourire, lors d’un échange sur le trottoir. Le bonheur ne dure que de brefs instants, mais ils symbolisent de véritables étincelles.
Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.
Photo : ©Francesca Mantovani – Gallimard
L’auteur : Erri De Luca est né à Naples en 1950 et vit aujourd’hui près de Rome. Écrivain, journaliste, poète ou encore traducteur, il publie en 1989 son premier ouvrage Non ora, non qui. Il remporte le Prix Femina en 2002 pour son livre Montedidio . Il est recompensé en 2013 du prix européen de littérature ainsi que du Prix Ulysse pour l’ensemble de son œuvre.
Erri de Luca, Les règles du mikado , 3 Mai 2024 (Éditions Gallimard)
Traduit de l’italien par Danièle Valin.
À retrouver chez mon libraire.